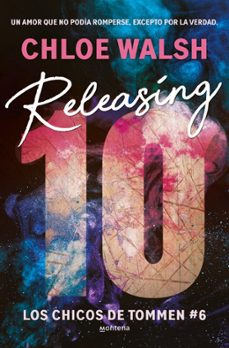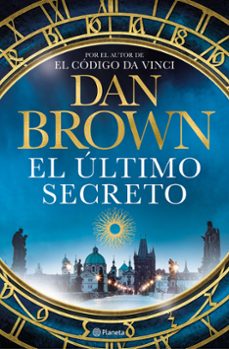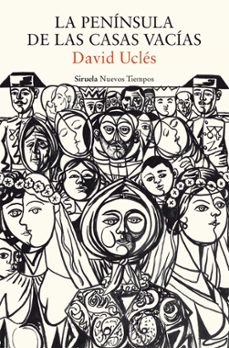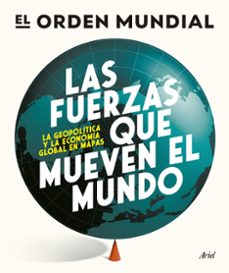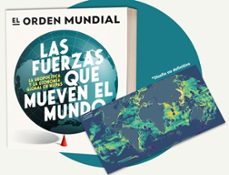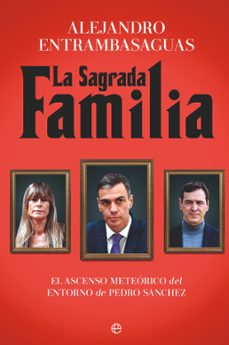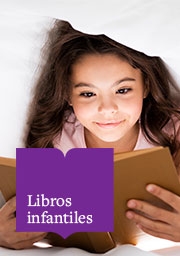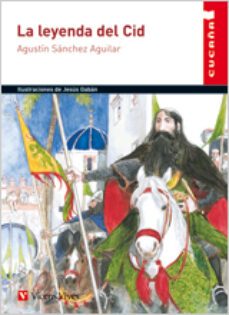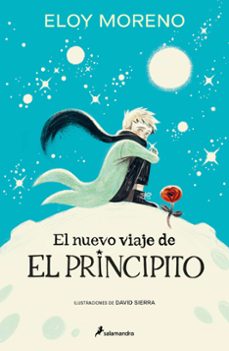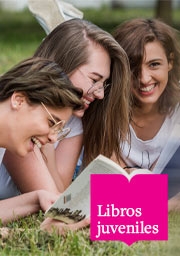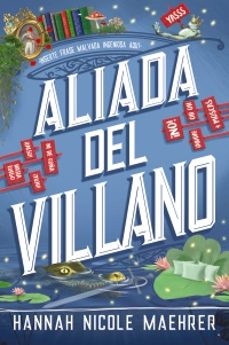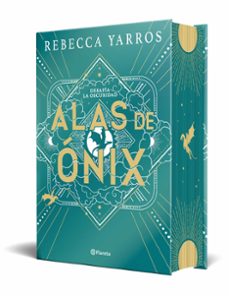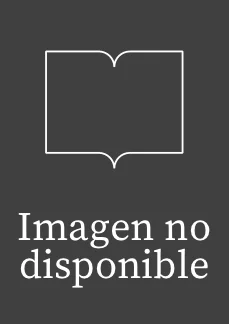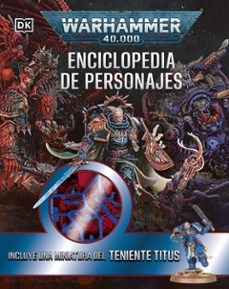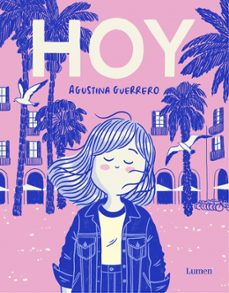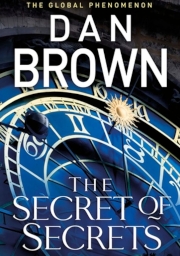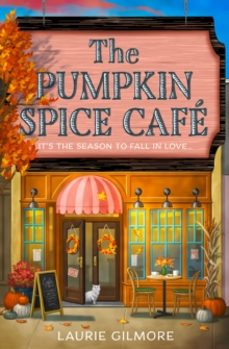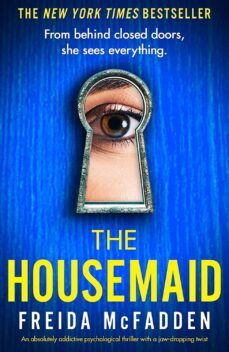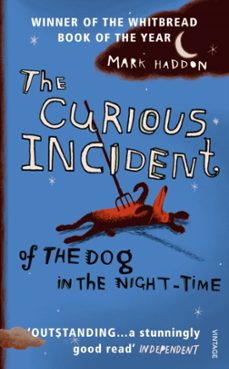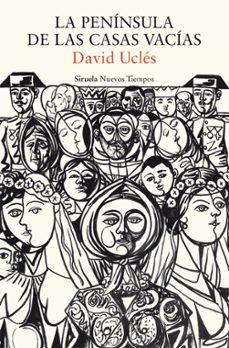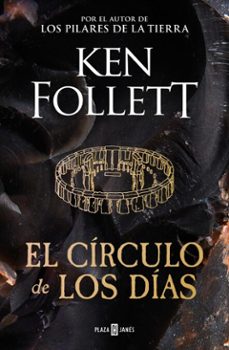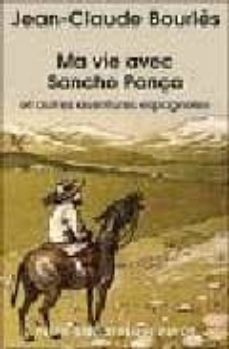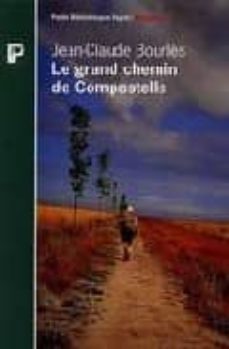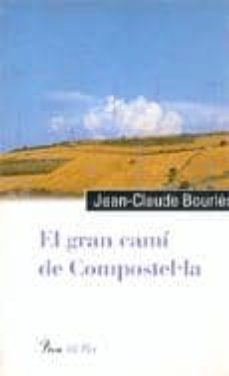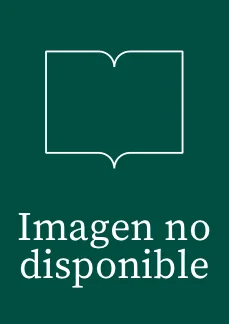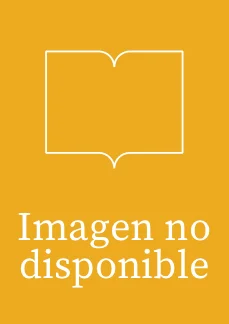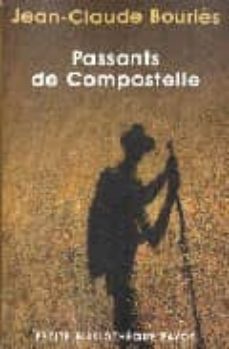Imprescindibles
Ficción
No Ficción
Ciencias y tecnología BiologíaCienciasCiencias naturalesDivulgación científicaInformáticaIngenieríaMatemáticasMedicinaSalud y dietas Filología BiblioteconomíaEstudios filológicosEstudios lingüísticosEstudios literariosHistoria y crítica de la Literatura
Humanidades Autoayuda y espiritualidadCiencias humanasDerechoEconomía y EmpresaPsicología y PedagogíaFilosofíaSociología Historia ArqueologíaBiografíasHistoria de EspañaHistoria UniversalHistoria por países
Infantil
Juvenil
Cómic y manga
Novela gráfica Novela gráfica americanaNovela gráfica europeaNovela gráfica de otros países Personajes, series y sagas Series y sagasStar Wars Superhéroes Cómics DCCómics MarvelCómics otros superhéroesCómics Valiant
eBooks
Literatura ContemporáneaNarrativa fantásticaNovela de ciencia ficciónNovela de terrorNovela históricaNovela negraNovela romántica y erótica Juvenil Más de 13 añosMás de 15 años Infantil eBooks infantiles
Humanidades Autoayuda y espiritualidadCiencias humanasEconomía y EmpresaPsicología y PedagogíaFilosofía Historia Historia de EspañaHistoria Universal Arte CineMúsicaHistoria del arte
Ciencia y tecnología Ciencias naturalesDivulgación científicaMedicinaSalud y dietas Filología Estudios lingüísticosEstudios literariosHistoria y crítica de la Literatura Estilo de vida CocinaGuías de viajeOcio y deportes
Jean Claude Bourles
Recibe novedades de JEAN CLAUDE BOURLES directamente en tu email
Filtros
Del 1 al 7 de 7
PAYOT 9782228899949
En panne d'inspiration dans la rédaction d'un ouvrage sur le XVIe siècle espagnol, un écrivain passe tout son temps à se raconter des histoires au fin fond de sa bibliothèque. Voici que surgit dans cette existence par procuration un drôle d'intrus répondant au nom de Sancho Pança. Bientôt d'autres figures étranges font leur apparition, qui incitent maître Bourlès à empoigner son bâton de marcheur aussi bien que ses livres pour partir à la recherche du créateur de ce petit monde, Miguel de Cervantès. À l'issue d'un périple semé de rebondissements, notre narrateur aura dépeint en une fresque somptueuse cette Espagne si bien incarnée par l'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Ver más
Tapa blanda
PAYOT 9782228891639
«Nous marchons, vers une ville de bout du monde. L'une de ces cités baroques, un peu mythiques, comme nous les aimons en Bretagne. L'un des ces hauts lieux de naufrage dispersés dans le monde, avec lesquels l'humanité errante aime à entretenir d'illusoires rendez-vous.»
Ver más
Tapa blanda
PAYOT 9782228494397
L'Orient arabe n'est pas celui de Nasser ni celui de la guerre des Six Jours, la "flamme panarabiste" s'est éteinte. Dans cette région du monde, États et populations aspirent à une cohésion entre pays, sans hégémonie ni conquérant, et la guerre du Golfe ne fut que le soubresaut d'une utopie déjà morte. Olivier Carré retrace l'évolution de la pensée nationaliste arabe depuis la naissance du Baas, à la fois philosophie et parti politique, jusqu'à l'effervescence de l'islamisme. Le nassérisme a marqué une époque et son retentissement perdure. Le nationalisme palestinien s'en est réclamé tout en le contestant. Mais depuis les années 1980, après avoir subi une influence marxiste, un nouveau courant prend en compte les minorités, ethniques ou confessionnelles, et dénonce les «États de terreur» panarabes.
Ver más
Tapa blanda
PAYOT 9782228894340
Cent vingt pèlerins furent recensés en 1982 à Compostelle mais en 1999, dernière année sainte compostellane du millénaire, ils furent plus de cent cinquante mille. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut bien pousser un individu à marcher jour après jour et dans des conditions parfois difficiles vers le lieu présumé de l'inhumation de l'apôtre Jacques le Majeur ? Cette question, Jean-Claude Bourlès se la pose depuis des années qu'il sillonne les mille six cents kilomètres d'un chemin prenant sa source au Puy-en-Velay. Après Retours à Conques et Le Grand Chemin de Compostelle, il interroge surtout les autres, les pèlerins mais aussi des témoins privilégiés : agriculteurs, commerçants et tous ceux, laïcs ou religieux, qui voient se succéder les "passants de Compostelle" et parfois les accueillent dans les gîtes, auberges ou refuges jalonnant leur itinéraire.
Ver más
Tapa blanda
Del 1 al 7 de 7